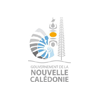Kelly Letellier, technicienne supérieure du laboratoire de microbiologie à l’Institut Agronomique néo-Calédonien (IAC). Découvrez son parcours en 10 questions.
1. Quel est votre parcours ?
Après mon BAC S, j’ai commencé un DEUG science car je voulais rester dans ce domaine. Au bout de 6 mois, ça ne m’a pas plu, j’ai donc essayé d’avoir une bourse australienne sans grand succès à cause de la complexité des dossiers. Ne voulant pas quitter la Nouvelle-Calédonie, je me suis inscrite en DEUST Revégétalisation et Gestion de l’Environnement Minier (RGEM), qui devait former seulement 30 techniciens sur le territoire. C’est durant ces années, que ma curiosité pour les travaux en laboratoire s’est vraiment développée et m’a orientée dans cette voie. Après l’obtention de mon diplôme, j‘ai été engagée en CDD pendant 6 mois à l’UNC sous la direction de Bruno Fogliani. J’ai ensuite travaillé pendant presque 3 ans au bureau d’étude SIRAS Pacifique, en tant que Technicienne polyvalente. Suite à cela, j’ai fait un an au Laboratoire de Nouvelle Calédonie (LNC) avant de postuler à mon CDI actuel à l’IAC.
2. Quels sont vos domaines de recherches actuels ?
Je fais de la recherche en biologie moléculaire et en mycologie. J’ai deux activités et deux chefs : d’un côté l’étude de la génétique des populations végétales avec Laurent Maggia et de l’autre l’étude de la diversité des réseaux micorhiziens en le lien avec leurs substrats (sol) avec Fabian Carriconde.
3. Quels aspects considérez-vous comme les plus marquants de votre carrière ?
Lors des travaux pratiques durant mon parcours scolaire j’ai été particulièrement marquée par la minutie nécessaire pour effectuer les différents gestes, la diversité de la verrerie et des manipulations de produits. En y réfléchissant, il y a aussi l’ensemble de mes professeurs de science, passionnés et passionnants, qui ont su me transmettre le goût du métier.
4. Quelles sont les applications de vos recherches ?
Une partie de la recherche à laquelle je participe porte sur la revégétalisation en Nouvelle-Calédonie, en particulier sur les sites miniers, car ce sont nos principaux bailleurs. D’abord, nous essayons de voir ce qui est présent dans le sol, comment cela fonctionne, pour tenter d’appliquer ces concepts sur d’anciens sites d’exploitation et les faire revenir à l’état naturel. L’un des projets en cours dans le Sud consiste à examiner s’il y a des flux de gènes entre les espèces naturellement présentes et une espèce agronomique replantée, afin d’améliorer les techniques de revégétalisation. En parallèle, il y a un autre projet qui porte sur l’étude de la symbiose ectomycorhizienne dans le sol, soit les interactions entre les plantes et les champignons.
5. Le quotidien d’un technicienne, c’est quoi ?
Dans la recherche, surtout au sein de mon laboratoire, j’ai la chance d’avoir des chefs qui me font confiance, ce qui permet d’avoir une certaine liberté dans la gestion de mon temps. Je gère la mise en forme des données, le déroulement des manipulations et la gestion du laboratoire et du stock, puisque je suis notamment en lien avec les fournisseurs. Au niveau des différents projets, comme j’ai deux chefs, je passe d’abord quelques mois sur un projet de l’un avant de passer au projet de l’autre, car les deux me demandent des techniques différentes. Il m’arrive de faire des manipulations en parallèle, si celles-ci ne me demandent pas trop de temps. J’aimerais bien analyser plus la donnée mais le nombre de projets m’en empêche, je manque de temps. Généralement ce sont les chercheurs qui font les traitements mathématiques sur les bases de données que je leur fournis.
6. Le moment où vous vous êtes dit « je veux travailler dans la recherche » ?
C’est venu au fur et à mesure, notamment parce que ce n’est pas répétitif, il y a toujours quelque chose à faire ou à améliorer. Alors qu’en laboratoire d’analyse, notamment au LNC, tout est normé et carré, il te suffit de suivre le protocole établi par l’accréditation. Dans la recherche c’est moins normé, tu cherches toujours à t’adapter à la situation ou à un résultat que tu n’attendais pas. Quand tu découvres une nouvelle espèce, il faut revoir les connaissances déjà acquises et les remettre à jour grâce aux nouvelles techniques. Avec Laurent notamment, nous avons dû refaire des arbres phylogénétiques.
7. Quelles sont vos plus belles réussites ?
Je n’ai pas vraiment eu de projet à moi, mais le fait de savoir que tu es « les petites mains » de nombreux projets et un maillon important de l’équipe, c’est valorisant. C’est d’autant plus valorisant quand le projet se finalise par la publication d’un article. Ça fait toujours plaisir de voir ton nom dans l’article.
8. Quelles sont, selon vous, les principales qualités que doit avoir un technicien ?
Je pense que le plus important c’est d’être ordonné, carré, propre, méticuleux, minutieux et patient. Si tu es bien organisé alors tu sais que tu es irréprochable sur ton travail et donc sur le résultat de tes données, surtout quand tu manipules de l’ADN. Si tu n’es pas méticuleux, tu peux facilement contaminer un de tes échantillons.
9. Quelle place accordez-vous au hasard (opportunités, rencontres, chance…) dans votre travail de recherche ?
Je pense que rencontrer des personnes de différents horizons te permet d’avancer. Les échanges durant les moments de pause ou les conférences te permettent de voir les choses sous un autre angle, ou de mêler les compétences pour mettre en place de nouveaux projets.
10. Quelle est, pour vous, la découverte majeure qui a influé l’histoire de la science et de l’humanité ?
La découverte de l’ADN, sans ça je n’aurais pas de travail. En plus, je pense que si on veut comprendre la complexité de l’infiniment grand, peut-être faut-il comprendre l’infiniment petit qui le compose.