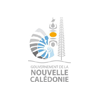Cécile Cazorla est chef de service Médecine Interne et Infectiologie et responsable de la Commission Recherche du CHT. Découvrez son parcours :
1) Quel est votre parcours ?
J’ai validé en 2004 ma thèse de doctorat en médecine dont le sujet était « Perception par les patients de leur séjour en réanimation ». Cette recherche clinique se concentrait sur les patients séjournant plus de 48h et ayant été intubés.
Ensuite, j’ai été Chef de Clinique des hôpitaux de Bordeaux en infectiologie pendant 2 ans puis Chef de Clinique des hôpitaux de Marseille en infectiologie pendant 1 an. A Marseille, j’ai travaillé dans l’équipe du professeur Raoult sur des Rickettsies à partir d’analyse PCR de tiques prélevées à travers le monde.
Je suis Praticien Hospitalier du service des Maladies Infectieuses depuis 2008 au CHT Gaston Bourret et Chef du Service depuis 2015.
Je préside la Commission Recherche du CHT depuis un an et demi. Le sujet principal à l’ordre du jour actuellement est l’adoption de la loi Jardé sur la recherche impliquant la personne humaine. La loi a été votée en Nouvelle-Calédonie mais il manque la publication du décret d’application. Ensuite, nous travaillerons à la création d’un centre de recherche clinique au sein du CHT.
Egalement, je bénéficie du partenariat avec l’Institut Pasteur, installé depuis peu dans les locaux du Médipôle, pour consacrer 10% de mon temps à des recherches cliniques menées en collaboration avec les chercheurs de cet institut.
2) Quels sont vos domaines de recherches actuels ?
Les sujets actuels de mes recherches sont la leptospirose et la lèpre dans le cadre de l’infectiologie. En pathologie métabolique, je travaille sur la goutte et sur l’amylose inflammatoire, une maladie où les protéines s’accumulent sur les organes et peuvent engendrer un dysfonctionnement des organes. Par exemple, si les protéines s’accumulent sur le rein, cela aboutit à une insuffisance rénale.
3) Quels aspects considérez-vous comme les plus marquants de votre carrière ?
Il y a 8 ans, nous avons eu en Nouvelle-Calédonie le 1er cas d’une infection par la bactérie Vibrio vulnificus sur un patient qui avait mangé des coquillages crus. Cette bactérie se développe dans les coquillages situés dans les eaux de bord de mer qui perdent en salinité du fait des conditions climatiques. Cette maladie est extrêmement grave, le taux de mortalité avoisine les 100%. Une enquête à ce sujet a été diligentée par la DASS et nous avons eu la chance de la visite des épidémiologistes du CDC d’Atlanta avec qui nous avons identifié les techniques de prévention. La rencontre avec ces experts était très enrichissante. Concernant la maladie, la grosse épidémie en Nouvelle-Calédonie s’est déroulée en 2008 et comptait 7 cas. Depuis, il y a quelques cas sporadiques mais cela reste marginal.
4) Le quotidien d’un chercheur, c’est quoi au juste ?
La plupart de mon temps je travaille en tant que Praticien Hospitalier et Chef de Service. J’ai environ une demi-journée hebdomadaire consacrée à la recherche. En ce moment avec l’Institut Pasteur je fais de la bibliographie, je relis les projets préliminaires et j’aide à la rédaction et à la mise en place pratique des projets. Je facilite également la mise en contact entre les membres de l’Institut Pasteur et mes collègues médecins. Je travaille actuellement sur la réaction de Jarisch-Herxheimer dans la leptospirose. Ce projet va bientôt débuter et je vais former mes collègues des autres services pour qu’ils puissent identifier les patients pouvant participer à l’étude. Je m’assure aussi que les prélèvements répondent aux contraintes fixées.
En parallèle, j’aide mes jeunes collègues qui ont des travaux de recherches en cours. En ce moment par exemple, je travaille avec un interne qui mène une recherche rétrospective sur les cas de lèpres pédiatriques sur le territoire ces dix dernières années.
5) Le moment où vous vous êtes dit : je veux faire de la recherche/de la médecine ?
Je me suis rendue compte que je voulais faire de la recherche en 2006 lorsque j’étais chef de clinique à Marseille. Dans mon emploi du temps, j’avais du temps de dégagé dans mon emploi du temps pour faire de la recherche fondamentale et c’est à ce moment-là que j’ai réellement découvert le monde de la recherche.
Après cela, j’ai réussi à intégrer la recherche dans ma pratique quotidienne. La direction du CHT est volontaire à ce sujet et souhaite développer la recherche clinique.
Il y a un an et demi, lorsque j’ai repris la Commission Recherche du CHT, j’ai commencé à me former sur les bonnes pratiques de la recherche. Cela m’a permis d’acquérir des compétences législatives, administratives, etc.
6) Quelles sont vos plus belles réussites ?
Récemment, j’ai soumis pour publication dans la revue Amyloid un article sur les amyloses inflammatoires en Nouvelle-Calédonie. C’est un très beau travail qui m’a demandé quasiment trois ans. Il y avait une thèse existante sur le sujet, j’ai ensuite réalisé une première étude rétrospective de 2006 à 2012 sur toutes les amyloses, ce qui a donné un travail de publication affiché au congrès international de l’amylose ISA au Japon en 2018 . Enfin, un interne a poursuivi le travail rétrospectif de 2012 à 2020. Nous avons co-écrit avec d’autres auteurs du centre de référence de l’hôpital Tenon cet article qui, nous l’espérons, pourra nous apporter une énergie nouvelle pour avancer dans nos recherches, voire nous apporter un financement pour mener une recherche fondamentale sur ce sujet.
C’est important que l’on soit reconnu, nos collègues en métropoles perçoivent ainsi qu’il y a une dynamique de recherche au CHT, c’est attractif.
7) Quelles sont, selon vous, les principales qualités que doit avoir un chercheur ?
Pour moi, un chercheur doit être rigoureux, persévérant et optimiste. Il ne faut pas lâcher prise et y croire jusqu’au bout. Il faut sans cesse se dire que nos choix, les hypothèses que l’on a émises, sont correctes. Il faut attendre le financement, que les personnes en charge du projet aillent jusqu’au bout… c’est très long, des années, il faut s’accrocher.
8) Quelle place accordez-vous au hasard (opportunités, rencontres, chance…) dans votre travail de recherche ?
Beaucoup, je dirais au moins 30%. Les occasions qui se présentent et les partenariats qui se nouent influent beaucoup sur les projets de recherche. Pour parvenir à réaliser un travail de recherche sur telle pathologie, il faut que plusieurs éléments s’alignent, il y a donc une grande part de chance.
9) Quelle est, pour vous, la découverte majeure qui a pu influer sur l’histoire de la science et de l’humanité ?
Pour moi c’est la découverte de la pénicilline en 1928 par Alexander Flemming. Avant cette découverte, les hommes mourraient très facilement de la pneumonie, des infections de la peau, des méningites… D’ailleurs, il a découvert par hasard les propriétés de la pénicilline, cela fait écho à la question précédente. En revenant de vacances, il découvre que certaines des boîtes de Petri où il faisait pousser des staphylocoques dans son laboratoire ont été contaminées par une moisissure. Il remarque qu’autour des colonies cotonneuses d’un blanc verdâtre, les staphylocoques n’ont pas poussé. Il émet l'hypothèse que ce phénomène est dû à une substance sécrétée par le champignon et mène ensuite des études à grande échelle qui lui ont permis de découvrir les propriétés de la pénicilline.
Une autre découverte exceptionnelle que j’ai eu la chance de vivre : l’avènement de la trithérapie contre l’injection par le VIH en 1995. Avant cela, le VIH était constamment mortel. J’étais externe à l’époque et j’ai vu le passage avant/après ce traitement : c’était une véritable révolution.